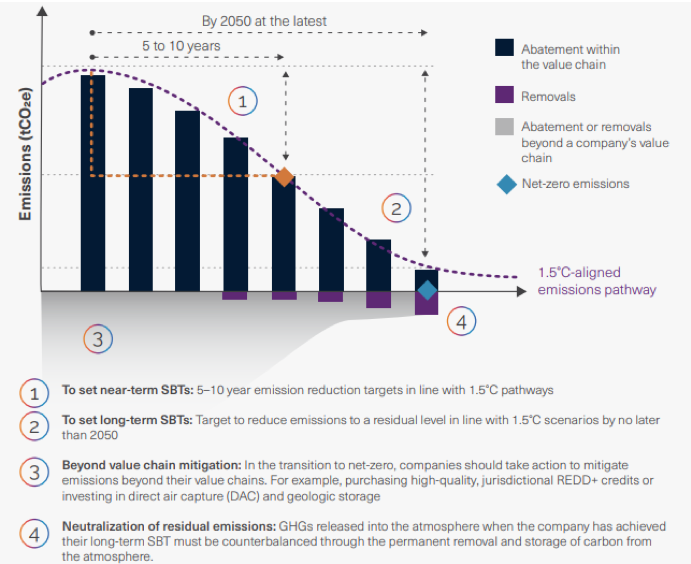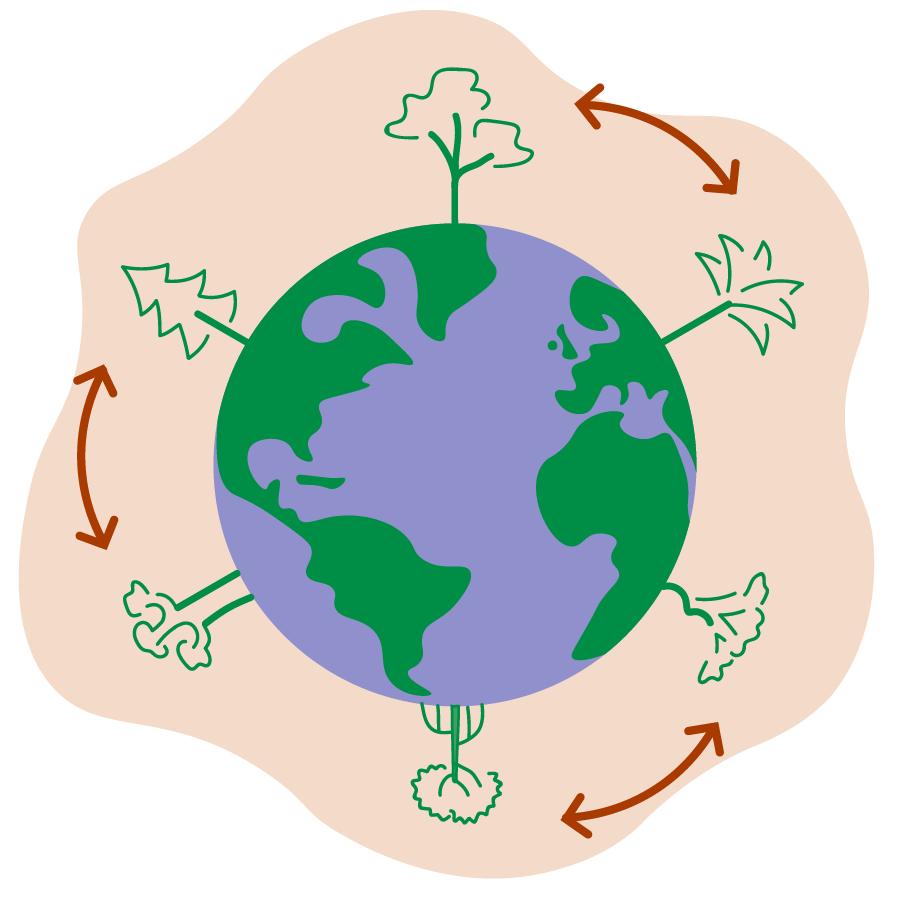https://iscmee.eu-science.com/
Il est de plus en plus évident que l'action climatique doit aller de pair avec le développement durable, la conservation de la biodiversité et l'autonomisation des communautés qui se trouvent en première ligne du changement climatique. Cette approche holistique est essentielle pour garantir que l'action climatique soit efficace, durable et adaptée aux contextes locaux. Par conséquent, les projets carbone doivent viser non seulement à éviter les impacts négatifs, mais aussi à générer des avantages pour l'environnement et les parties prenantes locales. Les co-bénéfices d'un projet peuvent inclure les impacts environnementaux, économiques, sociaux et culturels positifs d'un projet, et sont souvent inscrits aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, qui fournissent un cadre global pour relever les défis mondiaux.
Il existe un nombre croissant de standards de certification qui permettent aux développeurs de projets carbone de suivre et rapporter leurs contributions au développement durable. Il s'agit notamment de standards de certification carbone qui intègrent directement les impacts relatifs aux ODD, comme le Gold Standard et le Verified Carbon Standard (VCS), ainsi que des standards dédiés aux co-bénéfices, comme la Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB) et la Sustainable Development Verified Impact Standard (SD VISta), qui peuvent être combinés à une certification VCS ou, dans le cas de SD VISta, être utilisé pour générer des "actifs" d'impact d'ODD dédiés.
L'objectif de cet article est double : offrir un aperçu des principaux standards dits de "co-bénéfices" aux développeurs de projets qui envisagent de les adopter et apporter des informations utiles aux acheteurs potentiels de ces crédits. Ce faisant, nous souhaitons mettre en lumière l'aspect dynamique de ces cadres de certification, où l'action climatique converge avec les objectifs de durabilité au sens large.
Impacts ODD intégrés dans le cadre des standards de certification carbone
Jusqu'à récemment, le Gold Standard était l'une des rares normes internationales de certification volontaire du carbone qui exigeait des développeurs de projets qu'ils démontrent que leur projet contribuait à la réalisation d'au moins trois ODD. Pour chaque type de projet, les indicateurs SDG sont choisis grâce à l'outil SDG propriétaire de la Gold Standard, et toutes les déclarations faites sont auditées aux étapes de validation et de vérification. L'outil SDG indique également comment chaque indicateur SDG doit être quantifié et contrôlé. En outre, le Gold Standard soutient également la certification des impacts des ODD, tels que les labels de certificats d'énergie renouvelable, les certificats de bénéfices pour l'eau, les impacts sur l'égalité des sexes, l'amélioration des résultats en matière de santé et les réductions de carbone noir. Le Gold Standard a développé des méthodologies spécifiques pour certifier ces co-bénéfices, offrant ainsi une approche de quantification et de suivi plus complète.
Cependant, depuis janvier 2023, tous les projets nouvellement enregistrés dans le cadre du VCS de Verra doivent également démontrer que leurs projets contribuent à la réalisation d'au moins trois objectifs de développement durable. La principale différence entre les deux est que si le Gold Standard vérifie ces affirmations, le VCS ne vérifie pas nécessairement les résultats exacts obtenus. Les auditeurs se contentent de confirmer que les actions qui ont conduit à la contribution au développement durable ont bien eu lieu. Pour une inclusion et une vérification plus rigoureuses des objectifs de développement durable, les certifications SD VISta et CCB peuvent être ajoutées à une certification VCS afin d'aller plus loin et de garantir que les déclarations de développement durable sont solides et confirmées par une tierce partie indépendante.
Le Sustainable Development Verified Impact Standard (SD VISta)
SD VISta a été lancé début de 2019 et compte, en novembre 2023, plus de 35 projets enregistrés. Il permet aux développeurs de projets de revendiquer la contribution aux ODD de leurs projets et d'ajouter des "labels" aux crédits carbone émis par le VCS, mais aussi de générer des actifs ODD négociables, représentant une unité d'un impact spécifique en matière de développement durable. Si les développeurs de projets sont libres d'utiliser leur propre méthodologie pour quantifier les impacts, ils doivent utiliser une méthodologie approuvée par SD VISta pour générer des actifs ODD négociables. Il convient de noter que ces actifs ne doivent pas être utilisés à des fins de compensation.
En novembre 2023, il n'existait qu'une seule méthodologie SD VISta approuvée, qui permet aux projets de générer des unités de gain de temps à partir de l'utilisation de réchauds améliorés. Cela permet de cibler spécifiquement les ODD 5.4 et 8.4. En outre, le programme SD VISta développe actuellement une méthodologie relative à la biodiversité, appelée "Nature Framework", qui permettra aux projets de générer des crédits nature.
Les crédits nature, qui correspondent à une amélioration de la biodiversité dans une zone donnée, permettraient de financer des projets dans des zones écologiquement uniques mais menacées, afin de promouvoir la conservation écologique et d'empêcher la disparition d'espèces. Cette nouvelle initiative répond au besoin et à la demande croissante en matière de conservation de la biodiversité, en particulier aux objectifs du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. De plus amples informations sur ce nouveau cadre et sur les projets pilotes seront bientôt publiées.
Dans l'ensemble, le programme SD VISta va beaucoup plus loin qu'une simple certification VCS en faisant appel à des auditeurs experts tiers pour évaluer rigoureusement les contributions d'un projet au développement durable. Ce processus de vérification impartial garantit la fiabilité des déclarations relatives aux avantages sociaux et environnementaux générés par ces projets. Par conséquent, les acheteurs de crédits carbone labellisés SD VISta ont une assurance supplémentaire que les déclarations développement durable d'un projet ne sont pas exagérées et que les impacts du projet se sont réellement matérialisés.
Le Climate, Community, and Biodiversity Standard (CCB)
La standard CCB s'adresse spécifiquement aux projets carbone de changement d'affectation des terres qui, à la fois, s'attaquent au changement climatique, soutiennent les communautés locales et/ou les petits exploitants, et préservent la biodiversité. En novembre 2023, il comptait plus de 75 projets vérifiés (ayant délirés des crédits) et 50 autres projets en cours de validation (audit du concept du projet).
Tableau 1. Comment les différents standards abordent les contributions au développement durable
Le standard est utilisé pour générer des labels CCB, qui peuvent être ajoutés aux crédits émis par le VCS (les VCU), mais, contrairement à SD VISta, celui-ci n'offre pas la possibilité d'émettre des "actifs" biodiversité. Le CCB attribue le "niveau or" aux projets qui remplissent certains critères dans l'une ou l'autre des trois catégories (climat, communautés et biodiversité). Pour l'or climat, les projets doivent démontrer un impact positif net sur l'adaptation au changement climatique ; pour l'or communauté, les projets doivent être menés par des petits exploitants ou bénéficier directement à des communautés pauvres ou vulnérables ; et pour l'or biodiversité, les projets doivent protéger ou améliorer les zones clés pour la biodiversité.
Comme dans le cadre du standard SD VISta, toutes les déclarations faites par les projets sont rigoureusement vérifiées et évaluées par des auditeurs indépendants. Parmi les exigences du CCB, on peut citer l'évaluation approfondie des conditions de référence pour les communautés locales et la biodiversité dans la zone du projet, et la manière dont ces conditions pourraient évoluer dans le cadre du scénario référence et dans le scénario de projet. Ce processus implique de cartographier toutes les zones clés de biodiversité et à hautes valeurs de conservation présentes dans la zone du projet, et de développer une théorie du changement, en collaboration avec les communautés locales.
Pourquoi les développeurs de projets devraient-ils poursuivre une telle certification ?
Reconnaissant l'importance croissante de ces co-bénéfices, les acheteurs de crédits carbone recherchent de plus en plus à soutenir des projets associés à des impacts socio et environnementaux vérifiés, au-delà des réductions d'émissions carbone. Une étude de l'ICROA portant sur 59 projets carbone a révélé que chaque tonne de CO2e réduite ou séquestrée peut générer jusqu'à $664 d'avantages économiques, sociaux et environnementaux supplémentaires, au-delà de l'atténuation du changement climatique. Par exemple, outre la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts, les projets de distribution de réchauds améliorés tendent à améliorer la santé de leurs bénéficiaires et à réduire le temps consacré à la collecte et à l'achat de bois de chauffe, ce qui a un impact positif sur les femmes et les enfants qui portent souvent le fardeau de la cuisine et de la collecte du bois.
Un suivi efficace et une monétisation de ces avantages connexes permettraient d'orienter des flux financiers supplémentaires vers la réalisation des ODD à l'échelle mondiale. En outre, il est prouvé que les crédits carbone associés à des co-bénéfices vérifiés et bien documentés, tels que les crédits Gold Standard ou les crédits avec un label CCB ou SD VISta, se vendent avec un premium. D'après une analyse récente sur plus de 20 000 projets réalisés par Trove Research, les crédits issus de projets offrant des avantages sociétaux ont bénéficié d'un premium important, compris entre 15 et 40 %, en fonction du standard de certification. Les ODD ayant attiré les primes les plus importantes sont l'ODD 4 (éducation) et l'ODD 10 (réduction des inégalités). D'un autre côté, la première méthodologie d'actifs SD VISta n'ayant été approuvée que récemment, aucun projet n'a encore émis d'actifs négociables, ce qui rend la demande pour de tels produits et les prix auxquels ils se vendraient plus difficiles à prévoir.
Au-delà des préférences des acheteurs, il est probable que la pression réglementaire et les principales initiatives d'intégrité du marché volontaire du carbone (MVC) finiront par exiger (ou du moins par encourager fortement) des développeurs de projets qu'ils conçoivent des projets contribuant activement au développement durable. Les principes fondamentaux du Conseil de l'intégrité pour le marché volontaire du carbone (IC-VCM) stipulent que les projets carbone doivent avoir un impact positif sur le développement durable et que de solides garanties environnementales et sociales doivent être mises en place.
Défis possibles
Cependant, le suivi et la quantification des co-bénéfices des projets carbone n'est pas une simple affaire. Bien que certains standards, comme le Gold Standard, fournissent des indicateurs peuvant être suivis et quantifiés pour tout type de projet, ce n'est pas le cas pour tous les standards. Le SD VISta et le CCB n'exigent pas des développeurs de projets qu'ils utilisent une méthodologie spécifique, mais exigent que la méthodologie choisie soit justifiée et clairement décrite. Cela signifie que les impacts peuvent être calculés de différentes manières, ce qui rend les comparaisons entre les projets difficiles.
Cependant, il est important de trouver un équilibre entre flexibilité et standardisation, comme la création par le CCB de niveaux "Or", que les projets ne peuvent atteindre que s'ils répondent à certains critères. Cette approche vise à prendre en compte la diversité des projets, des objectifs et des contextes, tout en fournissant une référence pour l'excellence dans le cadre du programme.
De même, SD VISta et CCB permettent aux développeurs de projets de bénéficier d'une grande flexibilité dans le choix de l'étendue et de la quantité d'impacts à rapporter et des indicateurs à suivre. Cela est essentiel pour garantir que les standards restent adaptés à une grande variété de projets et de contextes. Par conséquent, les acheteurs potentiels doivent procéder à une analyse complète des projets qu'ils souhaitent soutenir, afin de s'assurer que les co-bénéfices générés par les projets correspondent à leurs préférences ou à leurs exigences.
Un autre défi pour les développeurs de projets est l'absence d'une prime de prix claire pour l'obtention de ces certifications supplémentaires de co-bénéfices. Toutefois, l'avènement des "Principes fondamentaux du carbone" du Conseil de l'intégrité pour le MVC est susceptible d'accroître la demande de crédits carbone de haute qualité, envoyant ainsi un signal de prix plus fort aux développeurs de projets, selon lequel une telle certification vaut le coût supplémentaire de sa mise en œuvre.
Conclusion
A un moment où l'action climatique est inextricablement liée au développement durable, à la conservation de la biodiversité et à l'autonomisation des communautés, la valeur des projets carbone de haute qualité ne peut être sous-estimée. Alors que la demande d'impacts positifs vérifiés continue de croître, les développeurs de projets et les acheteurs de crédits carbone devraient prendre en compte les avantages de faire certifier les co-bénéfices. Non seulement cela peut ouvrir la voie à des revenus supplémentaires, mais également de répondre à l'intérêt croissant des acheteurs pour des projets carbone bénéfiques sur le plan social et environnemental.
Chez HAMERKOP, nous comprenons l'importance des projets carbone de haute qualité qui améliorent de manière significative le bien-être des communautés locales et des écosystèmes. Notre expertise des marchés du carbone et du développement durable nous permet de fournir des conseils précieux aux développeurs et aux acheteurs de projets. Nous pouvons vous aider à choisir le bon standard de certification, à suivre et quantifier les co-bénéfices, et à garantir que vos déclarations sont rigoureusement vérifiées par des tiers indépendants. Contactez-nous pour plus d'informations.