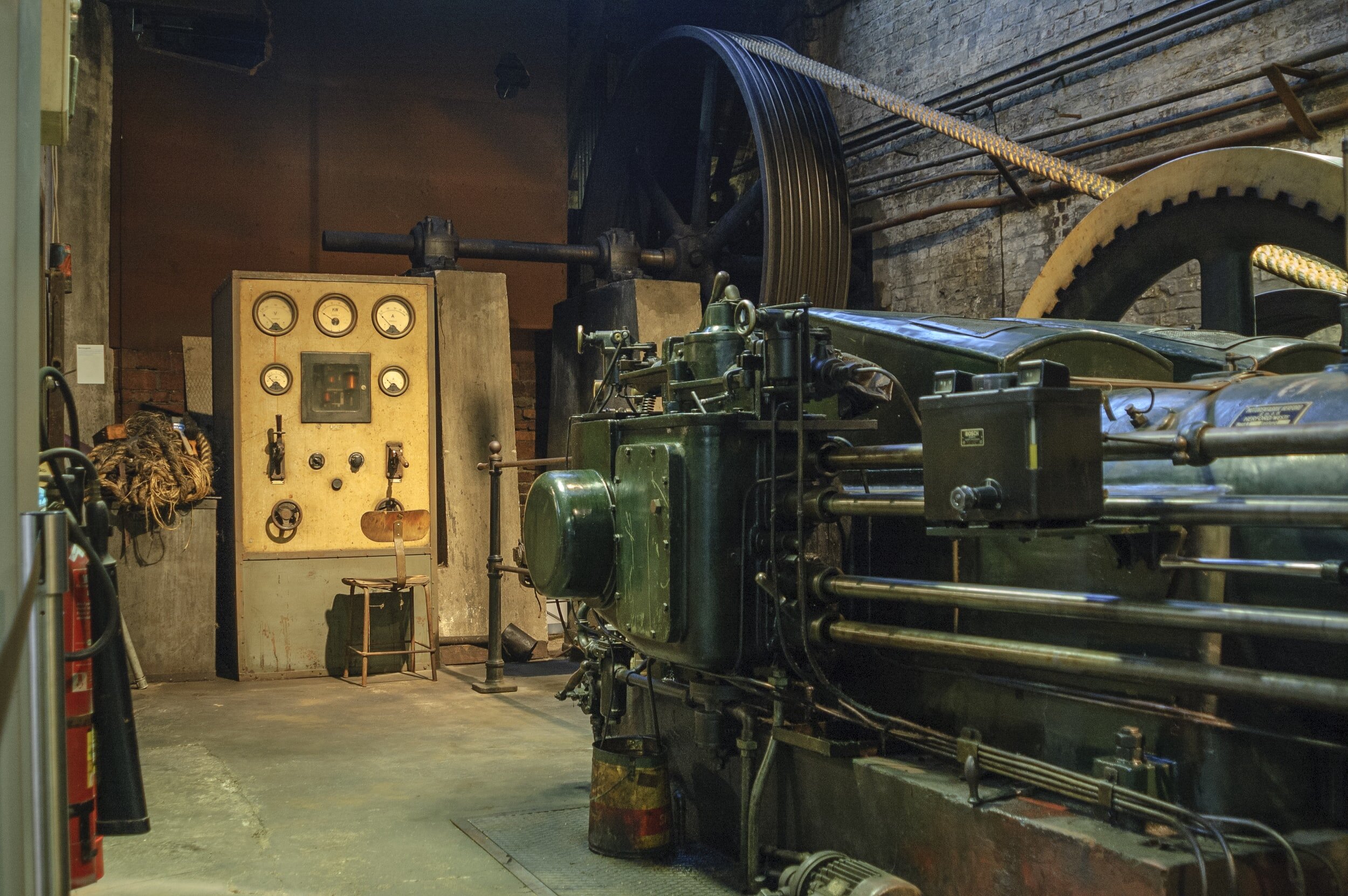Qu'est-ce que la compensation carbone ? Comment cela fonctionne-t-il ?
Les conséquences des changements qui affectent notre environnement sont et seront de grande envergure. Où que nous vivions, travaillions ou voyagions, nous devrions tous vouloir participer à l'effort de lutte contre le réchauffement climatique. Chez HAMERKOP, nous pensons que la compensation et la finance carbone (une branche de la finance climat) sont de puissants outils que les entreprises et les particuliers devraient comprendre et utiliser pour atténuer le changement climatique.
La compensation carbone (qui est en fait une compensation des émissions de gaz à effet de serre ou GES) permet d'équilibrer les émissions à un endroit donné grâce à un projet implanté ailleurs dans le monde. L'idée de compenser les émissions de GES est apparue à la fin des années 80 et repose sur la preuve scientifique que l'émission, l'absorption ou la réduction des émissions a le même effet, où qu'elle se produise dans le monde. En d'autres termes, puisque le changement climatique est un phénomène mondial, l'efficacité des actions visant à éviter que les GES ne pénètrent dans l'atmosphère ne dépend pas de l'endroit où ces actions sont menées.
La compensation carbone offre aux organisations ou aux particuliers la possibilité de financer des réductions d'émissions de GES pour une quantité correspondant à leurs propres émissions. Lorsqu'elles sont certifiées, ces réductions d'émissions peuvent être appelées unités de réduction des émissions, réductions d'émissions certifiées, unités de carbone volontaires, réductions d'émissions vérifiées, et bien d'autres noms, selon l'organisme certificateur qui les émet.
Dans cet article, nous examinerons tout d’abord les origines de la finance carbone, la différence entre le marché réglementé et le marché volontaire du carbone, et la manière selon laquelle les entreprises et les organisations peuvent équilibrer leurs propres émissions. Ensuite, nous étudierons la façon dont les crédits carbone sont émis ainsi que quelques autres concepts clés nécessaires pour comprendre les contributions de ces derniers aux efforts actuels de réduction du niveau des émissions de GES dans le monde.
La naissance des crédits carbone
La finance carbone telle que nous la connaissons aujourd’hui est apparue en 1997 avec le protocole de Kyoto. Un mécanisme basé sur le marché (également appelé cap-and-trade) et deux mécanismes basés sur des projets ont alors été conçus : le Mécanisme de Développement Propre (MDP, ou CDM en anglais) pour les pays en développement et la Mise en Œuvre Conjointe (MOC), pour les pays industrialisés. Ces mécanismes de projet servent à subventionner les activités de réduction des émissions de GES, fournissant une source de revenus supplémentaire ou complémentaire pour certains projets, voire la seule source de revenus pour d'autres. Ces mécanismes dits de flexibilité ont été rendus opérationnels par les Accords de Marrakech en 2001. Le MDP expire à la fin de l'année 2020.
Jusqu’à fin 2020, le MDP avait deux objectifs principaux : réduire le coût des réductions d'émissions pour les pays industrialisés (pays de l'annexe I du protocole) en leur permettant d'externaliser leurs réductions d'émissions vers des projets dans des pays où il est moins coûteux de le faire, et permettre aux pays en développement (pays hors annexe I) de bénéficier de financements pour des technologies plus propres et souvent plus coûteuses. Par ailleurs, l'objectif principal de la MOC était d'offrir un mécanisme financier aux pays industrialisés pour qu'ils amorcent la réduction des émissions au niveau national, notamment dans les secteurs où les émissions sont plus difficiles à réduire et qui ne sont pas couverts par un marché du carbone du type cap-and-trade.
Les deux mécanismes de projet de la finance carbone (MDP et MOC) ont été structurés de manière à fournir des incitations axées sur les résultats. Ce n'est que lorsque les projets ont démontré une réduction des émissions de GES qu'ils obtiennent des crédits carbone qui peuvent ensuite être vendus.
L’année 2015 a été marquée par la signature de l’accord de Paris. L'article 6 de ce traité international comprend des dispositions pour la prochaine génération d'instruments de finance carbone, pour lesquels les règles restent à développer, même si le traité entre en vigueur en janvier 2021.
Source : PNUE
Marché réglementé versus marché volontaire
Jusqu’à fin 2020, les crédits carbone délivrés pour des projets enregistrés au titre du MDP peuvent être utilisés par des sites industriels polluants pour remplir une partie de leurs engagements nationaux de réduction des émissions dans le cadre du protocole de Kyoto. Ces crédits carbone peuvent être utilisés et échangés dans le cadre d'un marché du carbone dit réglementé, un marché structuré à des fins réglementaires. L'exemple le plus notable de ce type de marché est le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne ou SEQE-UE (qui comprend par exemple 11 000 installations fortement consommatrices d'énergie). Dans le cadre de ces marchés, le type de crédits carbone qui peut être utilisé est généralement très limité. Comme le montre la carte ci-dessous, de nombreux pays ont mis en place diverses taxes ou marchés du carbone nationaux ou infranationaux.
Source : État et tendances de la tarification du carbone en 2019 - Banque mondiale
En parallèle, et à partir de 2006, un marché volontaire du carbone s'est développé. Ce marché volontaire rassemble généralement des entités qui achètent des crédits carbone pour soutenir des projets. Elles opèrent habituellement dans le secteur des services, des biens de consommation et du commerce de détail, mais peuvent également être des particuliers, des ONGs ou des organisations internationales.
Contrairement aux marchés réglementés organisés par les États, le marché volontaire du carbone n'est pas réglementé par une autorité centrale. Il n'y a donc pas de règles contraignantes concernant le type de crédits carbone éligibles. Par conséquent, en plus d'utiliser les crédits carbone issus du MDP, les organisations actives sur le marché volontaire du carbone utilisent de plus en plus des crédits carbone émis par des organismes de certification indépendants qui ont commencé à apparaître vers 2006 (bien avant, pour certains d'entre eux). Les plus utilisés sont actuellement le Gold Standard for the Global Goals (de la Fondation Gold Standard) et le Verified Carbon Standard ou VCS (de Verra). Aujourd'hui, la plupart des organisations qui compensent volontairement leurs émissions de carbone le font avec des crédits carbone issus de ces organismes de certification indépendants ou de standards de certification volontaires.
Comment les entreprises compensent-elles volontairement leurs émissions ?
Actuellement, la compensation consiste généralement en l'achat par une entreprise d'une quantité de crédits carbone correspondant à la quantité de GES qu'elle souhaite compenser et qui entre dans le périmètre 1, 2 ou 3 :
Les émissions du périmètre (ou scope) 1 sont les émissions directes de GES provenant de sources appartenant à l'organisation ou contrôlées par celle-ci (ex : la production sur place d'électricité, de chaleur ou de vapeur, les processus physiques et chimiques, le transport des biens et des personnes).
Les émissions du périmètre (ou scope) 2 sont les émissions indirectes de GES provenant de l'électricité achetée ou de la vapeur consommée par l'organisation (ex : l'électricité du réseau national).
Les émissions du périmètre (ou scope) 3 sont les émissions indirectes de GES émises par la chaîne de valeur de l'organisation déclarante (ex : les voyages d'affaires, les déplacements des employés, la production de matériaux achetés, les investissements, les actifs loués et les franchises, ainsi que l'élimination des déchets).
Source : Protocole sur les GES
Les montants que ces organisations versent pour acheter des crédits carbone contribuent directement ou indirectement au financement d'un projet spécifique de réduction des émissions de GES. Les promoteurs de projets qui reçoivent ces paiements mettent ensuite en œuvre toute une série d'activités, allant de l'installation d'infrastructures d'énergie renouvelable comme des éoliennes ou la récupération du biogaz des décharges à la plantation d'arbres qui stockent le carbone de l'atmosphère.
En 2019, la valeur transactionnelle de ce marché était estimée à 320 millions de dollars US, et représentait 104 millions de crédits carbone négociés[1].
Quelles réductions d'émissions peuvent être certifiées et monétisées sous forme de crédits carbone ?
La matérialisation de crédits carbone dépend des processus, règles et procédures uniques développés par chaque organisme de certification carbone. Actuellement, tous les organismes de certification carbone couramment utilisés ont fondé leurs règles de base sur celles du MDP. Par conséquent, les projets doivent offrir des réductions d’émissions qui soient réelles, mesurables, additionnelles, permanentes, vérifiables et uniques. Ces conditions de base sont brièvement définies ci-dessous :
être réelles : les réductions d'émissions doivent avoir effectivement eu lieu. Il doit y avoir une réduction d'émission sous-jacente à chaque crédit carbone qui correspond au résultat du projet mis en œuvre.
être additionnelles : les revenus de la vente des crédits carbone sont un facteur déterminant dans la mise en œuvre du projet. La survie du projet dépend, dans une certaine mesure, de la capacité du développeur de projet à vendre ses crédits carbone. En d'autres termes, cela implique que le projet n'aurait pas pu voir le jour s'il n'avait pas été soutenu financièrement par ce système de compensation. Ce concept est connu sous le nom d '"additionnalité".
être mesurables et vérifiables: les réductions d'émissions doivent pouvoir être calculées avec une rigueur scientifique et faire l'objet d'un suivi et d'un audit. Pour ce faire, il faut disposer de méthodes de calcul et de suivi adaptées au contexte et à la technologie concernés.
être permanentes : les émissions de GES qui ont été réduites ou évitées doivent durer dans le temps et ne doivent pas être rejetées dans l'atmosphère par le projet en question à une date ultérieure.
être uniques : chaque crédit carbone doit correspondre à une seule tonne de CO2e. Cela signifie également que des procédures doivent être mises en place pour éviter un double comptage.
L'additionnalité est un concept clé des mécanismes de la finance carbone. Si certaines conditions sont spécifiques à chaque organisme de certification, la détermination de l'additionnalité d'un projet se concentre généralement autour de ces questions clés :
Le projet est-il financièrement viable et susceptible d'attirer des financements sans vendre de crédits carbone ? La réponse doit être négative pour qu'un projet soit additionnel.
Le projet proposé comporte-t-il des risques qui rendent difficile son financement ou sa mise en œuvre ? La réponse doit être positive pour qu'un projet soit complémentaire.
Le projet proposé réduit-il/évite-t-il les émissions de GES au-delà des exigences réglementaires ? Le projet proposé est-il déjà une pratique courante à l’endroit où il est mis en place ? La réponse à ces deux questions doit être affirmative pour qu'un projet soit additionnel.
Le projet est-il confronté à des obstacles organisationnels, culturels ou sociaux importants qui ne peuvent être surmontés sans vendre des crédits carbone ? Cela doit être le cas pour qu'un projet soit additionnel.
Quelles sont ces normes de certification du carbone ?
Plus de 15 organismes de certification volontaire du carbone ont vu le jour depuis le milieu des années 2000. Le Gold Standard for the Global Goals (GS4GG), le Verified Carbon Standard, Plan Vivo, l'American Carbon Registry, la Climate Action Reserve, le Woodland Carbon Code et le Label Bas Carbone font partie des organismes actifs et largement reconnus par le marché.
Dans le cadre du processus de certification carbone, un projet doit être éligible à (i) un ensemble de conditions spécifiques aux spécificités du projet et aux (ii) règles et principes de l'organisme de certification choisi. Chaque organisme a ses propres exigences et critères d'éligibilité, basées notamment sur la localisation géographique, la taille ou la technologie du projet.
Chaque organisme de certification présente également un objectif qui lui est propre. Certains se limitent à des types de projets particuliers (ex : la foresterie pour le Woodland Carbon Code) tandis que d'autres excluent certains projets (ex : le Plan Vivo exclut les projets non communautaires), ou excluent des technologies en fonction de leurs caractéristiques pour se focaliser sur des projets valorisant les avantages sociaux (ex : les centrales hydroélectriques à grande échelle ne sont pas éligibles auprès du GS4GG).
Au-delà des réductions d'émissions, les organismes de certification volontaires exigent souvent d'un projet candidat qu'il génère des impacts connexes positifs dans le pays hôte. Ces impacts indirects impliquent généralement des contributions aux objectifs de développement dans des domaines importants : impacts sociaux (ex : réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, des discriminations à l'égard des femmes ou des minorités ethniques), économiques (ex : réduction de la pauvreté, accès à l'emploi et autres opportunités économiques), sanitaires (ex : réduction de l'exposition à la pollution atmosphérique, aux produits chimiques), environnementaux (ex : protection des forêts primaires, de la biodiversité, réduction des niveaux de pollution, augmentation de l'accès à l'énergie propre) ou humanitaires (ex : amélioration des moyens de subsistance des réfugiés). Ces impacts connexes sont souvent conformes à au moins un ou plusieurs des objectifs de développement durable des Nations unies.
Enfin, le choix de l'organisme de certification n'est pas seulement un choix du point de vue du projet, mais il oriente également le marché sur lequel les crédits carbone seront vendus et détermine les prix auxquels ils seront vendus.
La finance carbone comme mécanisme de financement efficace
Le soutien financier aux projets par le biais de crédits carbone est considéré comme un élément essentiel des efforts déployés pour lutter contre la crise climatique. La finance carbone apporte des solutions concrètes, à la fois efficaces sur le plan économique et environnemental, tout en offrant la possibilité de générer des impacts en termes de développement.
Par conséquent, la finance carbone :
est ouverte à tous les acteurs et entités.
permet la diffusion du savoir-faire et de l'expérience en matière de changement climatique parmi les entreprises et les institutions.
offre une source internationale de revenus pour les projets, sans les complexités des marchés de capitaux.
permet de dissocier l'équité de l'efficacité, et donc de répartir les charges, les pays riches facilitant les efforts d'atténuation dans les pays moins développés.
Au-delà de ces caractéristiques, la finance carbone est un mécanisme basé sur les résultats. Cela signifie qu'au lieu de payer pour des activités susceptibles de déclencher des résultats (comme c'est le cas pour l'aide au développement), les organisations désireuses de compenser leurs émissions par le biais du marché volontaire du carbone ne paient que pour des résultats fondés sur des preuves, lorsque les émissions ont déjà été réduites ou évitées. Cela signifie que les organisations qui compensent leurs émissions avec des crédits carbone ne financent que des projets qui fonctionnent réellement et montrent des résultats positifs. Plus un projet est efficace, plus il génère de crédits carbone et plus il bénéficie de la finance climat. Il y a donc un effet d’incitation pour les projets à être performants. L'efficacité devient ainsi une caractéristique essentielle des projets de compensation carbone.
Projets certifiés versus non certifiés
Aujourd'hui, presque la quasi-totalité des projets vendant des crédits carbone sont certifiés par un organisme de certification carbone reconnu qui délivre des crédits carbone labellisés. Ce n'était pas tout à fait le cas il y a dix ans. Les acteurs de ce milieu se sont appuyés sur les échecs passés et ont fait un effort important pour asseoir la crédibilité et la légitimité de leurs activités.
Si la compensation carbone est souvent critiquée, nombre de ces critiques sont mal formulées, dépassées ou portent sur la façon dont les entreprises l'utilisent ou communiquent à son sujet plutôt que sur la pertinence du mécanisme de financement. Contrairement aux organismes de certification intergouvernementaux tels que l'ONU qui ont malheureusement rencontré des difficultés à réagir à l'évolution rapide de ce marché et aux problématiques rencontrées, les organismes de certification volontaires, initialement mis en place pour combler certaines des lacunes du MDP, ont été des moteurs d'innovation. Ils ont renforcé leurs règles pour garantir l'intégrité environnementale et sociale des projets certifiés. Par exemple, le risque de double comptage est désormais pratiquement inexistant. C'est également le cas lorsqu'il s'agit de garantir la réalité des réductions d'émissions (c'est-à-dire le risque que des crédits carbone soient vendus par un projet qui n'a pas réduit d'émissions). Nous nous attendons prochainement à ce que les procédures de contrôle soient de plus en plus précises, à ce que les registres internationaux détenant les crédits carbone soient de plus en plus transparents et à ce que les garde-fous sociaux et environnementaux soient renforcés.
La compensation carbone comporte toutefois certains risques. Que vous souteniez un projet certifié ou non certifié, des difficultés non anticipées peuvent survenir et compromettre l’efficacité réelle de la démarche. Cela est d'autant plus vrai qu'il existe souvent une importante asymétrie d’informations entre le porteur de projet soutenu et l'entreprise compensant ses émissions. D'autre part, lorsque la compensation carbone est utilisée comme substitut par les entreprises pour ne pas réduire leurs propres émissions, cela peut engendrer des problèmes de réputation pour les dites entreprises.
Emissions réduites, évitées, séquéstrées et capturées
Crédit : Photo de Bas Emmen sur Unsplash
Lorsque l'on parle de réductions d'émissions monétisées sous forme de crédits carbone, le terme de réduction n'est pas toujours exact. Il renvoie souvent à une combinaison de situations et d'actions :
Emissions évitées : la plupart des projets carbone réduisent les émissions par rapport à une situation théorique qui se serait produite en l'absence du projet. Par exemple, si un pays a l'intention d'installer une centrale à charbon pour accroître sa production nationale d'électricité, car c'est le moyen le plus pratique et le moins cher de le faire, les crédits carbone peuvent rendre l'installation d'une centrale hydroélectrique alternative aussi intéressante financièrement en permettant d'éviter les émissions qui auraient eu lieu autrement. Dans ce cas, un crédit carbone représente une tonne de CO2e évitée et non réduite.
Emissions séquestrées : elles peuvent être classées en deux catégories :
Séquestration naturelle : la plupart des projets qualifiés de solutions fondées sur la nature (nature-based solutions) qui séquestre le carbone de l'atmosphère. Par exemple, lorsqu'un arbre pousse, le carbone est biologiquement séquestré dans ses branches, son tronc et ses racines. Dans ce cas, un crédit carbone représente une tonne de CO2e séquestrée ou réduite.
Séquestration via l'ingénierie de stockage : bien qu'aucun de ces projets ne soient encore certifiés, il s'agit d'une pratique de plus en plus répandue. Des technologies capables de capter le carbone directement de l'atmosphère (également appelée capture directe depuis l’air ou direct air capture) ou dans les gaz de combustion (capture et stockage du carbone ou carbon capture and storage) afin de le stocker dans des formations géologiques sont en cours de développement. Bien que l'efficacité de ces technologies soit encore incertaine et qu'elles soient actuellement sous-déployées, la capture de ces émissions pourraient être considérée comme des réductions. Dans ce cas, un crédit carbone représenterait une tonne de CO2e éliminée ou réduite.
Une entreprise qui compense ses émissions par des crédits carbone évite d'aggraver la situation en étant responsable mais n'empêche pas les émissions de continuer à s'accumuler dans l'atmosphère en niveaux absolus. La compensation n'a de sens que si elle est intégrée dans des plans ambitieux de réduction des émissions.
Conclusion
Dans cet article, nous espérons vous avoir donné un aperçu de ce qu'est la compensation carbone, de son fonctionnement, des réductions d'émissions qui peuvent être monétisées sous forme de crédits carbone, du fonctionnement des organismes de certification carbone et des raisons pour lesquelles elle est considérée comme un mécanisme de financement efficace.
Les experts d'HAMERKOP ont plus de 12 ans d'expérience dans l'aide aux entreprises, ONGs et gouvernements pour faire face à la complexité des processus de certification volontaire, depuis le choix de l'organisme de certification approprié jusqu'à la vente réussie de leurs premiers crédits carbone, en passant par le suivi de leurs projets, assurant ainsi leur viabilité économique, sociale et environnementale à long terme.
Si vous souhaitez vous engager sur le marché volontaire du carbone, que vous soyez une entreprise qui envisage de compenser ses émissions et cherche à comprendre quel projet ou quelle norme de certification soutenir et comment acquérir et négocier des crédits carbone, ou une organisation qui a un projet à venir qui réduit des émissions potentiellement éligibles pour vendre des crédits carbone ; nous pouvons vous aider, alors n'hésitez pas à nous contacter. Nous ne vendons pas de crédits carbone et nous pouvons donc vous conseiller de manière indépendante et vous mettre en contact avec les bons interlocuteurs.
—-
[1] Voluntary Carbon and the Post-Pandemic Recovery (Ecosystem Marketplace, 2020). Lien : https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/demand-for-voluntary-carbon-offsets-holds-strong-as-corporates-stick-with-climate-commitments/